14 liens privés
Pour permettre aux astronautes de boire leur café dans l'espace, la NASA a conçu une tasse "capillaire". En microgravité, les liquides ont tendance à coller aux parois sous l'effet de la tension de surface, ou à s'échapper du récipient. La forme particulière de la tasse capillaire permet d'exploiter la tension de surface pour accumuler le liquide à une extrémité en forme de bec verseur : le liquide s'écoule alors à l'extérieur, comme s'il était aspiré par une paille.

Pour réparer la caméra de la sonde spatiale Juno qui voyage à 600 millions de km de la Terre, la NASA a usé d'une technique audacieuse : le "recuit", qui consiste à surchauffer des composants électroniques afin de lisser les défauts à l'échelle microscopique. L'opération a été couronnée de succès : elle a grandement amélioré la netteté des images transmises.
Juno, Voyager... À qui le tour ?
Les astronautes de la Station Spatiale Internationale (ISS) peuvent s'entraîner "olfactivement". L'ISS a en effet sa propre odeur, décrite comme une odeur de viande, de plastique brûlé, d'ozone ou de poudre à canon, avec une note métallique. Un chimiste britannique a été chargé de la reproduire : ceci rend les entraînements plus immersifs et réalistes, et permet aux astronautes de s'habituer à l'odeur.
On connaît à ce jour 16 planètes qui orbitent autour de deux étoiles. 2M1510 (AB) b est l'une d'elles, mais elle présente en outre une particularité unique : son orbite est perpendiculaire au plan formé par les étoiles autour desquelles elle gravite.
Les planètes évoluant dans cette configuration sont plus difficiles à détecter et pourraient être plus nombreuses qu'on ne le pense.
Comme nos vieilles cartes graphiques passées au four...


Le champ magnétique de Jupiter a une particularité intrigante : il possède en quelque sorte 3 pôles. Son pôle nord est bien défini, mais elle possède deux pôles sud, l'un au pôle sud géographique, et un autre proche de l'équateur. Cela serait une conséquence de la structure interne de la planète.
En 1984, les astronautes Dale Gardner et Joseph Allen réalisèrent un exploit unique, digne d'une scène de film de science-fiction : sans harnais, et en utilisant seulement leur système de propulsion MMU, ils parvinrent à intercepter et à récupérer deux satellites qui avaient été placés sur une mauvaise orbite.
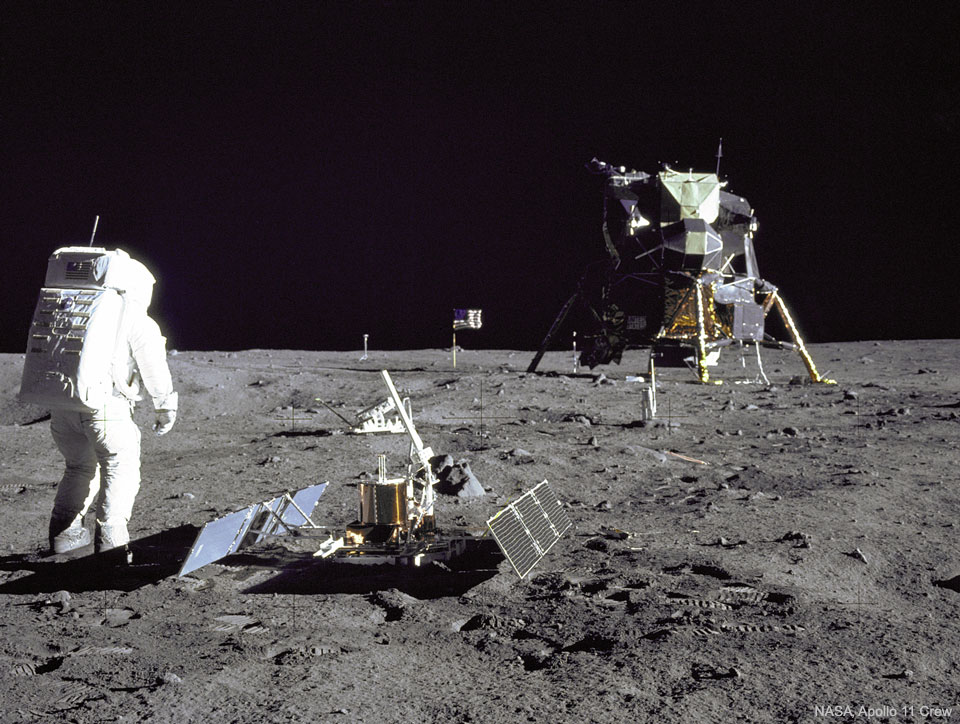
Une pomme cosmique


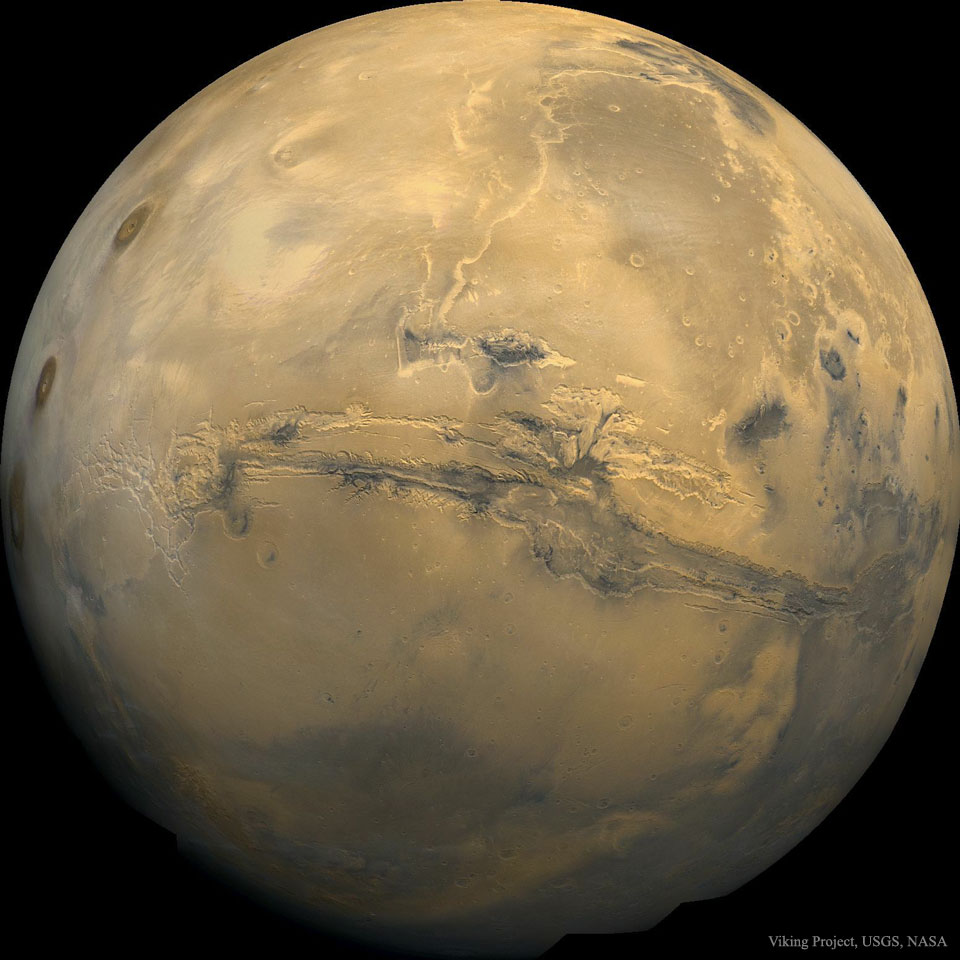
Depuis la fin des années 1950, toutes les fusées spatiales russes sont mises à feu avec un système rudimentaire, mais efficace : des sortes d'allumettes géantes en forme de T. Installées sous les chambres de combustion, ces pièces de bois de bouleau sont allumées grâce à des mèches électriques.
Leur mise à feu déclenche l'ouverture des vannes, et le carburant s'enflamme.

Comme les comètes, la planète Mercure a une queue. Longue de 20 millions de km environ, elle est principalement constituée de sodium, arraché de la surface par les radiations solaires et les impacts de météorites. On ne peut pas la voir à l'œil nu : il faut utiliser un filtre interférentiel.



