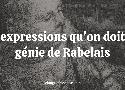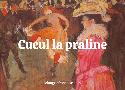14 liens privés
L’expression « un baroud d’honneur » évoque l’idée d’un combat dont on considère qu’il est perdu d’avance, mais que l’on mène néanmoins pour sauvegarder ou restaurer son honneur. Il s’agit d’une lutte où l’enjeu principal n’est pas tant la victoire que le maintien de sa dignité ou le respect de ses valeurs. Si l’issue de la bataille est déjà connue, le combat demeure engagé, soulignant ainsi la détermination et l’intégrité de ceux qui l’entreprendront.
[...]
L’histoire de l’expression « un baroud d’honneur » puise ses racines dans le dialecte berbère du sud du Maroc, également appelé le chleuh. Au sein de cette langue régionale, le mot « barud », signifiant « poudre explosive », a influencé le terme français « baroud », utilisé par métonymie pour désigner une bataille au sens large.À partir de 1924, cette locution a trouvé sa place dans l’argot militaire français, particulièrement pour faire référence aux batailles les plus difficiles, dont on présupposait qu’elles étaient vouées à l’échec. Toutefois, avec le temps, le sens strictement guerrier de l’expression s’est estompé. Elle en est venue à englober une multitude de combats, qu’ils soient littéraux ou métaphoriques.
- Les moutons de Panurge
- Aller à vau-l’eau
- L’habit ne fait pas le moine
- Être Gros-Jean comme devant
- À bâtons rompus
- La substantifique moelle
- Guerre picrocholine
- Quintessence
- La dive bouteille
- Le rire est le propre de l’Homme
Le mot « perpétrer » vient du latin perpetrare (« achever, mener à terme »). Il est synonyme de « faire ; accomplir » mais a pris une connotation péjorative au fil du temps. En effet, aujourd’hui, on emploie généralement « perpétrer » pour parler de la réalisation d’un délit, d’un acte malfaisant ou criminel.
Le mot « perpétuer » vient du latin perpetuare. (« continuer »), verbe dérivé de perpetuus (« continu, perpétuel »). Il désigne l’action de faire de durer quelque chose indéfiniment ou très longtemps. On l’utilise souvent à propos de souvenirs ou de traditions.
L'utilisation du mot "cancer" pour désigner la maladie est due à Hippocrate : il trouvait que les tumeurs et leurs excroissances ressemblaient à des crabes, et les appela "karkinoma" ("crabe" en grec). Cette comparaison fut reprise en latin, avec le mot "cancer", qui signifie également "crabe".
Un « vieux de la vieille » est une personne qui possède une grande expérience dans un domaine particulier.
Ce terme est synonyme d’autres expressions françaises qui mettent elles aussi en avant l’expérience et la connaissance, telles que « vieille moustache », « vieux briscard » ou encore « vieux routier ».
On entend parfois, aussi, des termes d’un registre militaire comme « être de la vieille garde » ou « de l’ancienne garde », c’est-à-dire faire partie des aînés ; par opposition à « la jeune garde », « la nouvelle garde » ou « la relève », représentant les jeunes sans expérience.
L’origine de cette expression nous transporte au XIXe siècle, où elle faisait initialement référence aux soldats de la garde impériale de Napoléon Ier, appelés les grognards. De fait, le terme « vieille » est une abréviation de « vieille garde ».
Ainsi, « être un vieux de la vieille garde » était un titre honorifique, car faire partie de cette armée napoléonienne était considéré comme un grand honneur. Le terme prend d’ailleurs un sens particulier lorsqu’on pense à la fameuse bataille de Waterloo, au cours de laquelle la célèbre phrase de Cambronne retient que « la garde meurt mais ne se rend pas ». Les soldats auxquels cette citation fait référence sont précisément ceux de cette « vieille garde ».
Le débat est ouvert quant à l’orthographe de cette expression ! Certains dictionnaires, comme le Littré, maintiennent que l’ancienne graphie « en un tournemain » n’a pas le même sens que « en un tour de main » ; tandis que l’Académie française considère que les deux orthographes sont interchangeables. À l’usage, nous vous laissons donc libre de retenir la forme qui vous convient le mieux.
Connue de tous, mais souvent source de perplexité quant à son origine, l’expression « cucul la praline » est bien ancrée dans le dialecte populaire français. Elle est ainsi largement utilisée dans le langage courant, pour qualifier quelqu’un de naïf, de sot ou d’enfantin.
[...]
L’expression « cucul la praline » (parfois raccourcie en « cucul ») est généralement associée à quelqu’un (ou quelque chose) de naïf ou de sot, témoignant d’une attitude enfantine, voire ridicule. Il évoque une innocence ou une candeur exagérée, tant et si bien qu’elle en devient risible, et en décalage avec le contexte qui l’entoure.Par extension, cette mièvrerie renvoie aussi à une forme de bêtise : l’expression « cucul la praline » désigne une certaine simplicité d’esprit, un comportement immature, ou une pensée dénuée de complexité.
[...]
Selon la légende, racontée dans Les 1001 expressions préférées des Français, tout commence aux origines de la praline. Celle-ci fut inventée au XVIIe siècle, par Clément Jaluzet, le chef cuisinier d’un certain duc du Plessis-Praslin, qui s’attribua le nom de la confiserie. Ce dernier était propriétaire d’un archipel également dénommé Praslin, situé aux Seychelles.Or, on trouvait sur ces îles un fruit semblable à la noix de coco, mais dont la forme suggestive rappelait celle d’une paire de fesses humaines, leur valant le surnom grivois de « coco-fesses ». Le chef Jazulet, à la réputation de grand maladroit, aurait justement créé la praline après de nombreuses expérimentations malencontreuses, dont l’une impliquait le mélange de « coco-fesses » avec du sirop de sucre.
Il n’en fallut pas moins pour associer la niaiserie du chef cuisinier avec le terme « coco-fesses », devenu « cucul », et avec sa délicieuse sucrerie dénommée « prasline », puis « praline ».
Cette histoire, sans doute romancée, fait toujours débat chez les linguistes, et les origines exactes de l’expression demeurent donc imprécises.
Le verbe "aller" en français est irrégulier. Sa conjugaison particulière vient du fait qu'il est un mélange de trois verbes distincts en latin : ire pour les formes en "ir" (irai), vadere pour les formes en "v" (vais, vont), et un troisième qui pourrait être ambulare pour les formes en "all" (allons), C'est un cas unique en français de trois verbes en un.
Astérisque est toujours masculin : le genre du mot « astérisque » est masculin. Attention donc de ne pas écrire « une astérisque » mais bien « un astérisque » ! Ce mot vient du latin asteriscus, issu du grec ancien ἀστερίσκος asterískos (« petite étoile »).
L’expression « virer sa cuti » trouve son origine dans le domaine médical, spécifiquement dans le test de la cuti-réaction. En effet, de 1949 à 2007 était obligatoire le vaccin BCG (vaccin Bilié de Calmette et Guérin) pour lutter contre la tuberculose.
Le test de la cuti-réaction servait, une fois le vaccin administré, à vérifier son efficacité en injectant au vacciné de la tuberculine. Si le patient est immunisé, alors la cuti « vire », c’est-à-dire qu’on observe une réaction cutanée sous forme de rougeur due à la réaction du corps contre le bacille de Koch, responsable de la tuberculose.
Ce test était devenu une sorte de rite de passage obligatoire pour les enfants, quelques jours après l’injection du vaccin BCG. C’est pourquoi l’expression a été popularisée au fil du temps.
L’expression « virer sa cuti » signifie, au sens figuré, être positif au test de la cuti-réaction à la tuberculine.
Par extension, « virer sa cuti » désigne le changement radical d’opinion, de conviction, de conduite ou d’orientation sexuelle.
À l’origine, l’expression « virer sa cuti » s’employait principalement pour décrire le changement de sexualité d’un homme hétérosexuel devenu homosexuel. On employait aussi l’expression dans le sens de « perdre sa virginité ». Aujourd’hui, ce sens de « virer sa cuti » est considéré comme familier, voire vulgaire, et a tendance à disparaître.
Désormais, cette expression est de plus en plus utilisée, dans un langage journalistique, pour décrire un changement brusque d’opinion, de conviction, de conduite, ou encore pour indiquer une transformation radicale dans d’autres domaines.
Bigre, ce n'est pas si simple :-(
L’expression « chat échaudé craint l’eau froide » est ancrée dans le patrimoine culturel français, et pour cause : son origine remonte au Moyen Âge. La première occurrence se trouve au XIIe siècle, dans le célèbre Roman de Renart, où elle est présentée sans référence à un animal spécifique : « l’échaudé craint l’eau » (eschaudez iaue creint).
Le XIIIe siècle marque l’ajout du mot « chat » : « chat échaudé craint l’eau » (chat eschaudez iaue creint) ; et c’est en 1584 que l’adjectif « froide » est employé par Adrien Turnèbe, consolidant ainsi la phrase que nous connaissons aujourd’hui : « Le chat une fois échaudé craint l’eau froide ».
L'expression "peuchère" très utilisée en Provence et notamment à Marseille, n'est pas une indication de basse valeur. Elle provient de "pêcheur", pas celui du poisson mais celui du péché religieux. Elle marque la commisération ou l'exclamation.
Après avoir perdu leur territoire canadien à la faveur des Anglais en 1763, la France se lança dans une "guerre des berceaux" : elle encourageait principalement via l'Eglise Catholique les couples à avoir beaucoup d'enfants, afin de maintenir une population française compétitive. Les curés faisaient du porte à porte, harcelant les femmes pour leur rappeler leur devoir, et la natalité explosa : un couple avait en moyenne 14 enfants !
Cette culture de la fécondité perdura jusque dans les années 1970, et donna lieu à des situations dramatiques : certaines femmes refusant d'enfanter pour raisons médicales étaient par exemple excommuniées.
Définition de l’expression « les chiens aboient la caravane passe »
« Les chiens aboient, la caravane passe » est une expression que l’on emploie, à propos de soi ou de quelqu’un d’autre, lorsque les injures, les critiques et les insultes formulées par autrui sont inutiles, sans effet, face à quelqu’un qui a une très grande confiance en lui (oui qui feint d’avoir confiance en lui).
La personne faisant l’objet des reproches est si sûre d’elle, tant convaincue de sa valeur, qu’elle en devient sourde aux critiques, même les plus virulentes. Celle-ci fait preuve de dédain à l’égard de ses calomniateurs ; mais attention : cette attitude peut la mener à une confiance exacerbée, et à une forme d’arrogance ou d’entêtement, face à des critiques parfois légitimes.
Comme souvent, la langue française comporte quelques expressions équivalentes : l’une des plus connues est « la bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe », qui traduit encore plus intensément le mépris ressenti face aux critiques, et le sentiment de supériorité par rapport à ceux qui les formulent.
Plus rares, les expressions « bien faire et laisser braire » ou « laisser pisser le mérinos » ont aussi un sens similaire. On trouve enfin, dans le registre familier, la formule « cause toujours, tu m’intéresses », qui exprime, elle aussi, l’idée de rester sourd aux paroles d’autrui.
Origine de l’expression « les chiens aboient la caravane passe »
L’expression « les chiens aboient, la caravane passe » est à l’origine un proverbe arabe, qui naît au Moyen-Orient autour du XIXe siècle. Le peuple nomade des Douars, originaire d’Afrique du Nord, emploie alors des chiens de garde pour assurer la sécurité de ses campements.
Or, à cette époque, le désert est régulièrement traversé par des « caravanes » : non pas le véhicule employé aujourd’hui par les vacanciers, mais un groupement de chameaux, transportant des personnes à travers le pays.
À l’approche de ces longues files d’animaux, les chiens de la tribu se mettent à aboyer, comme pour marquer leur territoire et repousser la « menace ». Imperturbables, les chameaux continuent pourtant leur chemin, sans sourciller, ni même jeter un regard à ces canidés qui leur hurlent dessus. L’analogie avec la personne qui fait mine de ne pas entendre les reproches qui lui sont adressés, et qui poursuit sa route sans hésitation, semble dès lors assez parlante.
L’expression d’origine arabe s’est ainsi distillée dans d’autres régions du monde : on la retrouve notamment dans les langues allemande (die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter), espagnole (los perros ladran, la caravana pasa), néerlandaise (de honden blaffen, maar de karavaan trekt verder) ou française, où elle demeure employée de nos jours.
L’inclinaison désigne l’état de ce qui est incliné, de ce qui est oblique par rapport à une ligne horizontale. Synonymes : déclivité, pente, obliquité.
L’inclination, de manière absolue, désigne l’action d’incliner la tête ou le corps en signe d’acquiescement ou de respect. De manière générale, l’inclination désigne l‘expression spontanée d’un sentiment envers quelque chose ou quelqu’un. Synonymes : penchant, goût, propension, sympathie.
Règle : Le verbe essayer accepte deux orthographes différentes lorsqu’on le conjugue. À la troisième personne du singulier, on peut donc écrire : « on essaie » ou « on essaye ». Le verbe essayer n’est pas le seul à s’écrire de deux façons, c’est aussi le cas d’autres verbes en -yer comme balayer, bégayer, déblayer, remblayer etc.
Attention, on n’écrit jamais « on essai » sans -e ou -ye ! Un « essai » est un nom commun qui désigne l’action d’essayer. Il est synonyme de tentative ou expérimentation.
J'adore les jeux vidéos vidéo.
Pour vous en souvenir, retenez que ce ne sont pas « des jeux et des vidéos », mais « des jeux au format vidéo ».