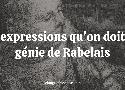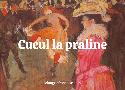14 liens privés
A l'origine, la marmelade est une pâte de fruits portugaise à base de coings. Le mot provient d'ailleurs du portugais "marmelada", dérivé de "marmelo" qui signifie coing. Les Anglais s'approprièrent la recette en l'accommodant et en remplaçant les coings par des agrumes.
La cravate est un symbole de l'élégance française, mais elle est d'origine croate : durant la Guerre de Trente Ans, au début du XVIIe siècle, le roi Louis XIII recruta des mercenaires croates qui portaient une étoffe autour du cou. Le nom "cravate" est d'ailleurs une déformation du mot "croate". La cravate s'imposa rapidement comme accessoire de mode à la cour de Louis XIV, avant de se diffuser dans toute l'Europe.
- Hard skill = Connaissances techniques
- Soft skill = Compétences
- Mad skill = Loisirs
Le mot dessert vient du vieux français desservir, qui signifiait "débarrasser la table" après le repas. Au fil du temps, il a évolué pour désigner la partie finale d'un repas, généralement sucrée, qui est servie après les plats principaux.
En Italie, les Grikos, une communauté culturelle existant depuis des siècles, continuent de parler grec. Avant le XIVe siècle, le quart méridional de l'Italie était majoritairement de langue grecque et les Grikos perpétuent l'usage de cette langue, même s'ils l'écrivent avec l'alphabet latin. Ils sont environ 40 000 dont la moitié parle la langue au quotidien.
Tout sur le bon emploi du subjonctif.
Le nom du Pakistan est à la fois un néologisme qui signifie "le Pays des Purs" en ourdou, mais serait aussi un acronyme des différentes régions composant le pays au moment de sa fondation en 1948. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur les provinces concernées, mais le Punjab aurait donné le « P », l’Afghania le « a », le Kashmir le « k », l’Indus-Sind le « is » et le Baloutchistan le « tan »
La Bolivie est le pays avec le plus de langues officielles : elle en compte pas moins de 37. Les trois principales langues sont l'espagnol (parlé par environ 60% de la population), le quechua et l'aymara. Les 34 autres sont des langues indigènes minoritaires, représentant 15% de la population.
Le Sénat a voté lundi pour une interdiction très large de l’écriture inclusive, encouragé par Emmanuel Macron, qui a appelé à « ne pas céder aux airs du temps ».
La lange ne doit plus vivre, ni évoluer... 🙁
L’expression « un baroud d’honneur » évoque l’idée d’un combat dont on considère qu’il est perdu d’avance, mais que l’on mène néanmoins pour sauvegarder ou restaurer son honneur. Il s’agit d’une lutte où l’enjeu principal n’est pas tant la victoire que le maintien de sa dignité ou le respect de ses valeurs. Si l’issue de la bataille est déjà connue, le combat demeure engagé, soulignant ainsi la détermination et l’intégrité de ceux qui l’entreprendront.
[...]
L’histoire de l’expression « un baroud d’honneur » puise ses racines dans le dialecte berbère du sud du Maroc, également appelé le chleuh. Au sein de cette langue régionale, le mot « barud », signifiant « poudre explosive », a influencé le terme français « baroud », utilisé par métonymie pour désigner une bataille au sens large.À partir de 1924, cette locution a trouvé sa place dans l’argot militaire français, particulièrement pour faire référence aux batailles les plus difficiles, dont on présupposait qu’elles étaient vouées à l’échec. Toutefois, avec le temps, le sens strictement guerrier de l’expression s’est estompé. Elle en est venue à englober une multitude de combats, qu’ils soient littéraux ou métaphoriques.
- Les moutons de Panurge
- Aller à vau-l’eau
- L’habit ne fait pas le moine
- Être Gros-Jean comme devant
- À bâtons rompus
- La substantifique moelle
- Guerre picrocholine
- Quintessence
- La dive bouteille
- Le rire est le propre de l’Homme
Le mot « perpétrer » vient du latin perpetrare (« achever, mener à terme »). Il est synonyme de « faire ; accomplir » mais a pris une connotation péjorative au fil du temps. En effet, aujourd’hui, on emploie généralement « perpétrer » pour parler de la réalisation d’un délit, d’un acte malfaisant ou criminel.
Le mot « perpétuer » vient du latin perpetuare. (« continuer »), verbe dérivé de perpetuus (« continu, perpétuel »). Il désigne l’action de faire de durer quelque chose indéfiniment ou très longtemps. On l’utilise souvent à propos de souvenirs ou de traditions.
L'utilisation du mot "cancer" pour désigner la maladie est due à Hippocrate : il trouvait que les tumeurs et leurs excroissances ressemblaient à des crabes, et les appela "karkinoma" ("crabe" en grec). Cette comparaison fut reprise en latin, avec le mot "cancer", qui signifie également "crabe".
Un « vieux de la vieille » est une personne qui possède une grande expérience dans un domaine particulier.
Ce terme est synonyme d’autres expressions françaises qui mettent elles aussi en avant l’expérience et la connaissance, telles que « vieille moustache », « vieux briscard » ou encore « vieux routier ».
On entend parfois, aussi, des termes d’un registre militaire comme « être de la vieille garde » ou « de l’ancienne garde », c’est-à-dire faire partie des aînés ; par opposition à « la jeune garde », « la nouvelle garde » ou « la relève », représentant les jeunes sans expérience.
L’origine de cette expression nous transporte au XIXe siècle, où elle faisait initialement référence aux soldats de la garde impériale de Napoléon Ier, appelés les grognards. De fait, le terme « vieille » est une abréviation de « vieille garde ».
Ainsi, « être un vieux de la vieille garde » était un titre honorifique, car faire partie de cette armée napoléonienne était considéré comme un grand honneur. Le terme prend d’ailleurs un sens particulier lorsqu’on pense à la fameuse bataille de Waterloo, au cours de laquelle la célèbre phrase de Cambronne retient que « la garde meurt mais ne se rend pas ». Les soldats auxquels cette citation fait référence sont précisément ceux de cette « vieille garde ».
Le débat est ouvert quant à l’orthographe de cette expression ! Certains dictionnaires, comme le Littré, maintiennent que l’ancienne graphie « en un tournemain » n’a pas le même sens que « en un tour de main » ; tandis que l’Académie française considère que les deux orthographes sont interchangeables. À l’usage, nous vous laissons donc libre de retenir la forme qui vous convient le mieux.
Connue de tous, mais souvent source de perplexité quant à son origine, l’expression « cucul la praline » est bien ancrée dans le dialecte populaire français. Elle est ainsi largement utilisée dans le langage courant, pour qualifier quelqu’un de naïf, de sot ou d’enfantin.
[...]
L’expression « cucul la praline » (parfois raccourcie en « cucul ») est généralement associée à quelqu’un (ou quelque chose) de naïf ou de sot, témoignant d’une attitude enfantine, voire ridicule. Il évoque une innocence ou une candeur exagérée, tant et si bien qu’elle en devient risible, et en décalage avec le contexte qui l’entoure.Par extension, cette mièvrerie renvoie aussi à une forme de bêtise : l’expression « cucul la praline » désigne une certaine simplicité d’esprit, un comportement immature, ou une pensée dénuée de complexité.
[...]
Selon la légende, racontée dans Les 1001 expressions préférées des Français, tout commence aux origines de la praline. Celle-ci fut inventée au XVIIe siècle, par Clément Jaluzet, le chef cuisinier d’un certain duc du Plessis-Praslin, qui s’attribua le nom de la confiserie. Ce dernier était propriétaire d’un archipel également dénommé Praslin, situé aux Seychelles.Or, on trouvait sur ces îles un fruit semblable à la noix de coco, mais dont la forme suggestive rappelait celle d’une paire de fesses humaines, leur valant le surnom grivois de « coco-fesses ». Le chef Jazulet, à la réputation de grand maladroit, aurait justement créé la praline après de nombreuses expérimentations malencontreuses, dont l’une impliquait le mélange de « coco-fesses » avec du sirop de sucre.
Il n’en fallut pas moins pour associer la niaiserie du chef cuisinier avec le terme « coco-fesses », devenu « cucul », et avec sa délicieuse sucrerie dénommée « prasline », puis « praline ».
Cette histoire, sans doute romancée, fait toujours débat chez les linguistes, et les origines exactes de l’expression demeurent donc imprécises.
Le verbe "aller" en français est irrégulier. Sa conjugaison particulière vient du fait qu'il est un mélange de trois verbes distincts en latin : ire pour les formes en "ir" (irai), vadere pour les formes en "v" (vais, vont), et un troisième qui pourrait être ambulare pour les formes en "all" (allons), C'est un cas unique en français de trois verbes en un.
Astérisque est toujours masculin : le genre du mot « astérisque » est masculin. Attention donc de ne pas écrire « une astérisque » mais bien « un astérisque » ! Ce mot vient du latin asteriscus, issu du grec ancien ἀστερίσκος asterískos (« petite étoile »).